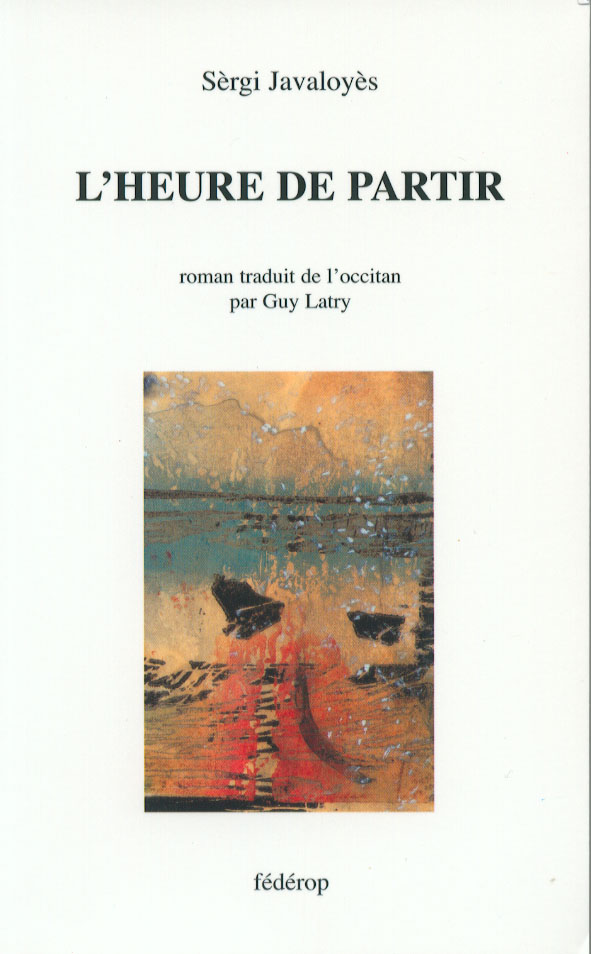…
Du regard, je m’échappe dehors et essaie de trouver une
mouette dans le grand ciel bleu. Trois le traversent vite, une autre
lentement, avec une tache noire sur une aile. Je la suis des yeux. Elle
monte, plonge soudain jusqu’à raser le faîte des
arbres. C’est à croire qu’elle va tomber. Mais
non!Un coup d’aile et allez, elle reprend de l’altitude,
pour enfin, apaisée, se laisser porter par le vent…
Traduit de l’occitan, écrit selon un plan circulaire, L’Heure de partir
raconte les cinq derniers mois de la guerre d’Algérie
à travers les yeux d’un jeune garçon de 12 ans,
exilé de sa terre oranaise et transporté en terre de
Béarn où il découvre l’hiver, la neige, le
froid. C’est le roman palimpseste d’un double exil : celui
d’un gamin qui prend soudain conscience qu’il n’est
pas de ce peuple auquel il pensait appartenir, qu’il n’est
plus considéré comme légitime sur cette terre, et
qui va se retrouver en France, la patrie mère pourtant, dans un
autre exil, celui des rapatriés. Pauvre à Oran, pauvre en
Béarn, il se construit sur une toile de fond dont
l’altérité est la trame.
Article :
"Le drame des rapatriés
d’Algérie a déchiré des centaines de
milliers d’existences... A-t-il fini par se dissoudre dans la
prospérité française des Trente Glorieuses ? Il
aura laissé en tout cas des blessures inguérissables,
notamment chez les adultes d’aujourd’hui qui ont dû
se construire sur ce traumatisme subi pendant l’enfance. De
nombreux romans et récits ont relaté ces drames
individuels sur fond de tragédie collective. L’une des
œuvres les plus originales est le roman autobiographique de
Sèrgi Javaloyès, au titre évocateur, L’heure de partir,
déjà paru en 1997 en version originale occitane qui a
obtenu le prix Joan Bodon 1998 (variété gasconne) et dont
Fédérop propose aujourd’hui une traduction
française.
Œuvre originale à plus d’un titre
par la mise en abîme sur laquelle reposent à la fois le
destin du narrateur et la construction romanesque. L’histoire
éditoriale de ce roman le laisse entendre en effet : le parcours
de l’auteur, qui passe par celui de son narrateur enfant,
n’est rien moins que banale. Le récit présente une
tranche de la vie d’un garçon de 11 ans, François,
au moment de la « grande catastrophe », celle de la
dispersion d’une communauté dans le chaos de la guerre,
pendant l’automne 61. Il commence sous la neige de novembre dans
le village béarnais de Bourdalas, où les parents de
François l’ont envoyé pour le mettre à
l’abri des attentats qui ensanglantent Oran (ville jamais
nommée). La jeune femme qui l’accueille dans sa famille
est une amie de la tante de François, Tantine Angèle. Les
deux femmes se sont connues au sanatorium. C’est que les parents
et grands-parents de François appartiennent à la
communauté d’origine espagnole, née de
l’émigration et de la misère, et n’ont aucune
famille dans la métropole, qu’ils ne connaissent
même pas. François se retrouve donc dans cette famille
providentielle mais étrangère, où l’on ne
parle que l’occitan du Béarn. Les six autres chapitres se
passent en Algérie pendant les trois mois
précédents et racontent la montée des
périls quotidiens, depuis le mitraillage de l’école
jusqu’aux attentats incessants de l’O.A.S ou de
l’A.L.N et le départ en avion pour la France.
L’heure de partir,
on l’a compris, est un roman sur l’exil, ou plutôt
sur les exils, qui s’enchaînent récursivement dans
une spirale tragique. Exilés, les ancêtres espagnols ou
valenciens de François, qui ont troqué en Algérie
leur misère noire pour une pauvreté décente.
Répit historique de courte durée : la guerre rappelle
à la famille Milagros-Tena, de la façon la plus violente,
qu’elle est étrangère, pire : colonialiste, et
qu’elle devra partir à nouveau. Étranger à
son tour, le petit François dans une France qu’il ne
connaît pas, malgré la tendresse de sa famille
d’accueil. Et c’est ici enfin que s’ébauche un
autre exil, hors roman, suggéré seulement par le choix de
la langue originale : l’exil du Béarnais d’adoption
dans la France d’aujourd’hui, « en étrange
pays dans son pays lui-même ». Une sorte de fatalité
atavique inscrit le narrateur dans le camp des victimes de
l’histoire.
L’heure de partir est
aussi un roman de formation, un éveil du printemps dans un
automne tragique. Il est rempli de présences féminines
qui enchantent cet univers de malheur et de violence. Les deux
sœurs béarnaises Anne-Lise et Maïlis sont à la
fois mères et objets de désir pour le
pré-adolescent. Le même désir œdipien inspire
l’évocation de la mère, que des rêves
nocturnes obsédants présentent dans d’innommables
postures. Mais la figure la plus pathétique est celle de
Tantine, la jeune tante maternelle d’à peine plus de vingt
ans, malade de tuberculose, dont l’agonie double en contrepoint
métaphorique la tragédie collective. Isabel Alvarez
enfin, seize ans, est l’initiatrice sexuelle,
passionnément aimée, dont l’absence finale
inéluctable met un comble au désarroi de François.
Elle est doublée par des figures plus évanescentes,
Isabelle Bethbéder, la fille du boulanger, ou Sarah Simon, la
belle rousse. Les hommes sont moins radieux dans cet univers
littéraire, à l’image de l’oncle
Eugène, aigri, raciste et violent, gagné par le fanatisme
de l’O.A.S.
La technique narrative exprime de façon
originale cette saison chaotique. Sept chapitres en relatent au
présent un moment chacun : une soirée de neige, une
journée d’école, un trajet vers cette même
école, un après-midi à l’église, un
lever après une nuit d’insomnie, la matinée du
départ. À partir de ces ancrages dans le présent,
le narrateur fait des incursions dans son passé plus ou moins
récent, par remontées successives.
Cette narration subjective dessine de la sorte, par
scènes et touches perçues à hauteur
d’enfant, un monde en cours d’écroulement et un
destin en train de basculer. Sous sa simplicité apparente et son
évidence narrative, ce roman autobiographique est une
œuvre originale et riche, qui dépasse largement le simple
intérêt historique ou anecdotique."
Jean-Claude FORÊT